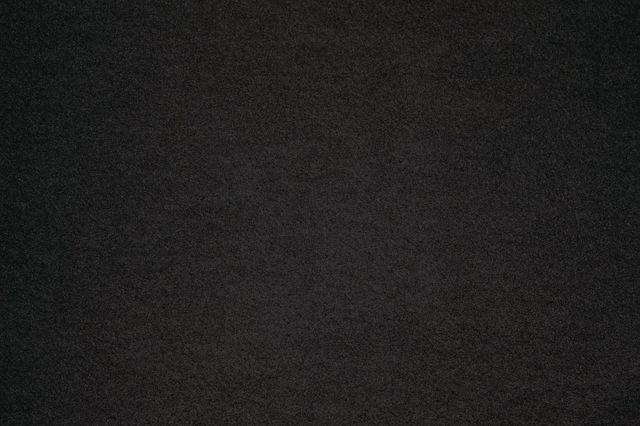A
abaxial : face opposée à l’axe ; dans une feuille c’est sa face inférieure.
abscission : chute physiologique d’un organe, telle celle des feuilles en automne ; l’acide abscissique ou dormine intervient dans ce processus.
accrescent : qui continue sa croissance après la floraison
aciculaire : étroit, raide, allongé et pointu, en forme d’aiguille
acropète : qui se développe vers l’apex (contraire de basipète)
actinodrome : se dit d’une nervation foliaire palmée
actinomorphe : à symétrie radiale ; disposé en rayons ; opposé à zygomorphe
acuminé :
terminé en pointe progressivement effilée
adaxial :
face qui regarde l’axe ; dans une feuille c’est la face supérieure ;
adné :
se dit d’un organe paraissant soudé à un autre
adventice : se dit de plantes qui poussent spontanément sans avoir été semées
adventif, -ive : qui naît à un endroit inhabituel sur une plante : racine adventive ;
aigu : à sommet rétréci en angle aigu
akène : fruit sec, indéhiscent, à 1 seule graine non adhérente à la paroi du fruit
amplexicaule : se dit d’une feuille, bractée ou stipule dont la base entoure l’axe
ampullacé : en forme de flacon ou de bouteille
anastomosé : réuni à d’autres éléments et formant un réseau
androcée : ensemble des étamines d’une fleur
androgyne : se dit des inflorescences qui portent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles
androdioïque : se dit d’une plante dont certains sujets n’ont que des fleurs mâles et d’autres n’ont que des fleurs hermaphrodites, aucun sujet ne portant de fleurs femelles.
andromonoïque : se dit d’une plante dont un même pied porte à la fois des fleurs hermaphrodites et des fleurs uniquement mâles
anémochorie : dispersion des graines par le vent
anémogame : pollinisé grâce au vent (synonyme : anémophile)
anémophile : pollinisé grâce au vent (synonyme anémogame)
anthère : partie de l’étamine qui contient les grains de pollen, le plus souvent à 2 loges elles-mêmes pouvant avoir 2 sacs polliniques
anthèse : ouverture, épanouissement d’une fleur
anti- : préfixe marquant l’opposition, signifie souvent "en face de"
antrorse : dirigé vers l’extrémité
apétale : dépourvu de pétales
apex : pointe, extrémité, sommet d’un organe
aphylle : dépourvu de feuilles
apical : relatif à l’apex
apicule : extrémité (d’une feuille par ex.) abrupte, courte, pointue, mais non effilée
apiculé : qui porte un apicule
appendice : Se dit de n’importe quel élément dépassant d’une autre partie du végétal
appendiculé : qui porte des appendices
apprimé : appliqué mais non soudé : écaille sur une cupule de gland, poils + ou - couchés sur une feuille…
aptère : dépourvu d’aile
aranéeux : se dit de poils fins enchevêtrés comme dans une toile d’araignée
arborescent : qui a les caractéristiques d’un arbre
arbre, arbuste, arbrisseau, sous-arbrisseau : classification de végétaux ligneux fondée sur des aspects dimensionnels et morphologiques. Cette distinction entrée dans le langage commun permet d’avoir une idée de la hauteur des essences à maturité, mais cette classification doit être relativisée car la croissance et le développement des végétaux ligneux varient fortement en fonction des conditions environnementale
arbrisseau : plante ligneuse à tiges ramifiées dès la base et en général d’un mètre ou 2 maximum.
arbuste : plante ligneuse d’une taille entre 4 et 7 mètres à l’état adulte, et dont le tronc est plutôt grêle, à la différence de l’arbre qui fait plus de 7 mètres à l’état adulte. En botanique cette catégorie dimensionnelle et morphologique s’intègre dans la série : arbre, arbuste, arbrisseau, sous-abrisseau.
arbrisseau : plante ligneuse de moins de 4 m de hauteur, se ramifiant dès la base et dépourvu de tronc, ce qui le distingue de l’arbuste qui a un tronc et fait entre 4 et 7 m de hauteur. Sa forme est dite « buissonnante » (ramification dès la base).
aréole : petite tache bien limitée, ayant une texture et/ou une couleur différente de ce qu’il y a autour
arête : poil long et rigide
aristé : muni d’une arête fine et droite ; souvent sur une marge foliaire ou à l’extrémité d’une dent ou d’un lobe ;
article : entre-nœuds
articulé : formé de plusieurs articles
ascendant : qui passe progressivement de la position horizontale à la position verticale
atténué : qui se rétrécit progressivement vers l’extrémité
auricule : petit lobe en forme d’oreille situé à la base d’une feuille contre le pétiole
auriculé : en forme d’auricule
autogame : plante dont la fleur est fécondé par du pollen de la même fleur (contraire de allogame)
autotrophe : se dit d’un organisme qui puis directement dans le milieu environnant les éléments nécessaires à sa nutrition.
axe : élément central et allongé d’une plante, d’une inflorescence, d’une fleur, d’une branche
axillaire : situé à l’aisselle d’une feuille ou d’une bractée
B
bacciforme : ressemblant à une baie
baie : fruit charnu, indéhiscent : , contenant plusieurs graines, rarement une seule, libres dans le tissu charnu
barbu : muni de longs poils disposés en touffe ou en aigrette
basifixe : attaché par sa base
basilaire : attaché à (ou près de) la base ;
basipète : qui se développe vers la base (contraire de acropète)
Biocénose (ou biocœnose) : ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, plus leurs organisations et interactions. Ensemble, le biotope et la biocénose forment un écosystème. Au sein de la biocénose, les écologues distinguent couramment :
– la phytocénose, qui regroupe les espèces végétales,
– la zoocénose, qui regroupe les espèces animales,
– la microcénose, qui regroupe les microorganismes (terme encore rare ; anglais microcenose ou microcenosis ou microcoenosis)
– la mycocénose, qui regroupe les champignons,
– la pédocénose, qui désigne la biocénose du sol.
– Les terres agricoles cultivées constituent un écosystème particulier : l’agroécosystème ; on parle aussi d’agrobiocénose pour désigner la biocénose d’une telle zone.
biotope type de lieu de vie défini par des caractéristiques physiques et chimiques déterminées relativement uniformes. Ce milieu héberge un ensemble de formes de vie composant la biocénose : flore, faune, fonge (champignons), et des populations de micro-organismes. Un biotope et la biocénose qu’il accueille forment un écosystème caractéristique. L’évolution de cet écosystème tend vers un climax momentané, qui change avec notamment le climat, manifestant un nouvel équilibre du biotope.
brachy- : préfixe signifiant court
brachyblaste : rameau court, sans entre-nœuds distincts
bractéole : petite bractée, habituellement formée sur un pédicelle floral
brochidodrome : se dit d’une vénation foliaire dans laquelle les nervures se divisent à leur extrémité sur la marge foliaire avec les branches qui s’anastomosent
buisson (synonyme : arbrisseau) : Plante ligneuse ramifiée dont la taille est inférieure à 1 mètre dans tous les sens, le plus souvent regroupés en formation végétale de type touffe et rarement solitaires.
C
calcariforme : en forme d’éperon
cambium : assise génératrice du xylème vers l’intérieur et du phloème vers l’extérieur
campanulé : en forme de cloche
camptodrome : se dit d’une vénation foliaire dans laquelle les nervures qui atteignent la marge la longent en se dirigeant vers l’apex
campylodrome : se dit d’une vénation foliaire dans laquelle les veines issues de la base foliaire suivent plus ou moins la direction du rebord foliaire
canaliculé : marqué d’un sillon en gouttière, ou de rainures longitudinales
canescent : couvert d’une pilosité courte, dense, de couleur cendre
cannelé : à côtes longitudinales séparées par des sillons
carène : saillie allongée à la surface d’un organe
caréné : muni de ou en forme de carène
carpelle : constituant du gynécée, formé d’un ovaire, d’un style et d’un stigmate
cartacé : qui a la texture du parchemin (synonyme : chartacé)
caudé : se dit d’une feuille dont le sommet est rétréci en appendice allongé, mou, flexible, comme une queue
caulescent : muni d’une tige plus ou moins développée
cauliflore : se dit de plantes ligneuses dont les fleurs naissent sur le tronc ou les tiges
centrifuge : se développant à partir du centre
centripète : se développant vers le centre
céracé : qui a la texture de la cire
cespiteux : qui croît en touffe
chartacé : qui a la texture du parchemin (synonyme : cartacé)
chaton : inflorescence en épi formée de fleurs unisexuées insérées à l’aisselle de bractées scarieuses
cime : l’ensemble des rameaux feuillés d’un arbre
cincinnus : cyme unipare scorpioïde
circiné : enroulé en crosse
cireux : couvert d’un enduit + ou - collant, comme de la cire d’abeille
claviforme : en forme de clou ou de massue
cleistogame : se dit d’une fleur où l’autofécondation se fait dans le bouton floral fermé
clone : individu issu d’un autre par propagation végétative, donc génétiquement identique
coalescent : lié mais non soudé
cochléaire : en forme de coquille d’escargot, en colimaçon
concolore : de couleur uniforme, de même couleur sur les 2 faces
condupliqué : plié en 2 vers l’intérieur le long de l’axe principal
cône : inflorescence faite d’un ensemble d’écailles disposées en hélice sur un axe
conné : se dit de 2 organes opposés et soudés par leur base
connectif : zone axiale d’une étamine, prolongeant le filet dans la partie apicale élargie où se forment les sacs polliniques
connivent : qui convergent à l’extrémité, sans se souder
contorté : tordu en spirale
convoluté : à bord enroulé vers l’extérieur, du côté ventral. S’oppose à révoluté
cordé : à base échancrée en forme de coeur
cordiforme : en forme de coeur
coriace : à consistance de cuir
corné : à consistance de corne
cornu : qui porte des cornes
corolle : ensemble des pétales
corymbe : grappe dont les ramifications latérales naissent à des hauteurs différentes sur l’axe principal, de telle sorte que toutes les fleurs se trouvent à la même hauteur, ayant l’apparence d’une ombelle
costa : nervure médiane d’une feuille
côte : crête longitudinale
côtelé : muni de petites côtes
cotylédon : première feuille présente dans l’embryon de la graine, souvent nourricière, de morphologie souvent très différente des feuilles suivantes ;
craspédodrome : se dit d’une vénation foliaire pennée dans laquelle les veines secondaires se terminent à la marge foliaire, souvent dans des dents
crassulescent : épais et charnu
crénelé : à dents arrondies ou obtuses
crispé : à bords ondulés-frisés
crochet : organe rigide et recourbé
crustacé : rigide, ferme et épais
cucullé, cuculliforme : en forme de capuchon
cultivar : variété née en culture
cunéé, cunéiforme : en forme de coin
cupule : involucre en forme de coupe, d’une seule pièce ou composée de petites écailles imbriquées, à la base de certains fruits (gland)
cupuliforme : en forme de petite coupe
cuspide : pointe longue, droite, aiguë et raide
cyathiforme : en forme de coupe ou de cyathium
cyme : inflorescence définie dont l’axe se termine par une fleur et dont les axes latéraux également terminés par une fleur apparaissent ultérieurement ; une cyme peut être unipare, bipare, multipare ; dans le premier cas, elle est soit hélicoïdale, soit scorpioïde .
cymeuse : se dit d’une inflorescence en forme de cyme, ou à croissance définie et sympodiale
cymule : petite cyme
D
dauciforme : en forme de carotte
décidu : dont toutes les feuilles tombent en même temps à une certaine période
décliné : courbé vers le bas ou vers l’avant
décombant : se dit d’une tige d’abord horizontale puis redressée à son extrémité, retombant sous son propre poids
décrescent : diminuant de taille avec le temps
décurrent : qui se prolonge sur les pétioles ou sur la tige
décurvé : courbé, recourbé
décussé : se dit de feuilles opposées dont les paires successives sont insérées dans des plans perpendiculaires
défini : se dit d’un axe dont la croissance est limitée mais où le développement peut se poursuivre par les ramifications
défléchi : courbé brusquement vers l’extérieur et le bas
déhiscence : ouverture naturelle permettant au contenu d’un organe mûr de s’échapper
deltoïde : largement triangulaire
denté : à bords pourvus de dents
denticulé : à bords pourvus de très petites dents
déprimé : enfoncé, en creux, concave
dextrorse : s’enroulant de gauche à droite
dialypétale : à pétales libres (contraire de gamopétale)
dialysépale : à sépales libres (contraire de gamosépale)
dichasiale : se dit d’une croissance du type de la cyme bipare
dichasium : cyme bipare
dichogamie : décalage entre la maturation des anthères et des stigmates (pour éviter l’autogamie) : dans la protandrie, la partie mâle est mûre avant la partie femelle, dans la protogynie c’est la partie femelle qui est mûre la première.
dichotomique : qui se sépare en 2 d’une façon régulière
didyme : fendu en 2 moitiés égales
diffus : ramifié de façon lâche, ou dans toutes les directions
digité : disposé comme les doigts d’une main
dimorphe : qui a 2 formes différentes
dioïque : qualifie une plante dont les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur des sujets différents
diphylle : à 2 feuilles
disamare : fruit formé de 2 carpelles évoluant en akènes ailés séparément
disciforme, discoïde : en forme de disque
discolore : qui a 2 couleurs différentes, comme une feuille dont la face supérieure n’a pas la même couleur que l’inférieure
disque : excroissance du réceptacle floral sur laquelle sont fixées les étamines ; souvent nectarifère ;
distal : éloigné de la base (contraire de proximal) ; situé du côté du sommet
distique : disposé de part et d’autre d’un axe commun, dans un même plan
divariqué : qui s’écarte dans toutes les directions sur un plan horizontal
divergent : qui s’écarte dans tous les sens à partir d’un même point
dolabriforme : feuille qui a une forme cylindrique à la base, plane et élargie au dessus, épaisse d’un côté et tranchante de l’autre (en forme de doloire ou hache de tonnelier)
dolicho- : préfixe signifiant long
domaties : nom donné aux touffes de poils situés à l’aisselle de la veine médiane et des veines secondaires à la face inférieure de certaines feuilles (Quercus)
dorsal, e : se dit de la surface d’un organe située à l’extérieur par rapport à un élément de référence : pour une feuille c’est la face abaxiale
drageon : tige partant de la souche souterraine d’une plante, à partir d’un bourgeon adventif racinaire ;
drupacé : qui a l’aspect ou la consistance d’une drupe
drupe : fruit charnu contenant une graine dont l’endocarpe est induré
E
écaille : organe de structure plus ou moins coriace ou membraneuse, résultant de la transformation d’une feuille, d’une bractée, d’un poil aplati.
écailleux : garni d’écailles, ou ayant la forme et la consistance d’une écaille
échancré : à large et profonde entaille au sommet
échiné : couvert de longues épines raides ou d’aiguillons
écotype : forme biologique d’une espèce adaptée à un habitat particulier
elliptique : en forme d’ellipse
émarginé : légèrement échancré au sommet
endémique : qui est propre à une région géographique donnée, souvent restreinte
endocarpe : couche la plus interne du péricarpe d’un fruit, souvent ligneuse ;
ensiforme : en forme de lame d’épée
entier : à bords non découpés ni dentés
entomophile, -game : fécondé par du pollen transporté par les insectes
entre-noeud : portion de tige comprise entre 2 noeuds ou insertions foliaires
épi : inflorescence indéfinie, à fleurs sessiles et disposées le long d’un axe, la fleur terminale étant la plus récente
épicarpe : couche externe du péricarpe du fruit (synonyme : exocarpe)
épigé : qui pousse au dessus du niveau du sol
épine : appendice piquant provenant de la transformation de stipules, de rameaux ou de feuilles
épiphyte : plante qui pousse sur une autre sans en être parasite
erchogamie : séparation spatiale maximale des étamines et des stigmates dans une même fleur (par ex. des étamines beaucoup plus grandes ou petites que les stigmates, dans le but d’éviter l’autogamie) ;
érodé : à bord irrégulier, comme rongé
étamine : organe mâle de la fleur produisant le pollen
ethnobotanique : discipline qui étudie les rapports complexes que les hommes entretiennent avec le monde des plantes, et les classifications des plantes en fonction des systèmes culturels
étoilé : à segments en rayons, comme les branches d’une étoile
exine : paroi externe et résistante d’un grain de pollen ; sa surface est caractéristique d’une espèce du fait de son apparence (pores, pointes, plis, tubercules)
exocarpe : couche externe du péricarpe du fruit
exsert : saillant, dépassant en longueur les éléments environnants ; s’oppose à inclus
extrorse : tourné vers l’extérieur
F
faisceau :
f. libéro-ligneux : groupe de vaisseaux de xylème et de phloème, visibles sur la coupe transversale d’une tige
falciforme : en forme de faux ou de faucille
falqué : en forme de faux ou de faucille
fascicule : groupe d’organes réunis en faisceau
fastigié : qui a tous les rameaux dressés et rapprochés les uns des autres
fimbrié : à bords découpés finement en minces lanières filiformes, formant une frange
flabellé : en éventail, ou plissé comme un éventail fermé
flabelliforme : en forme d’éventail
foliole : élément foliaire de base d’une feuille composée
forêt galerie : formations boisées dont la canopée est jointive au-dessus d’une rivière ou d’un petit fleuve, ou d’une zone humide (la présence de l’eau pouvant éventuellement être temporaire)
forêt ripisylve (synonyme : rivulaire, riveraine : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours d’eau, d’une rivière ou d’un fleuve, la notion de rive désignant le bord du lit mineur (ou encore lit ordinaire, hors crues) du cours d’eau non submergée à l’étiage. La notion de ripisylve désigne généralement des formations boisées linéaires étalées le long de petits cours d’eau[Information douteuse], sur une largeur de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, ou moins (si la végétation s’étend sur une largeur de terrain inondable plus importante, dans le lit majeur d’un cours d’eau, rivière ou fleuve, on parlera plutôt de forêt alluviale, de forêt inondable ou inondée ou de forêt rivulaire
forêt riveraine : (voir forêt ripisylve)
forêt rivulaire : (voir forêt ripisylve)
fovéolé : à surface garnie de petites fossettes
frutescent : se dit d’une plante ligneuse qui a les caractéristiques d’un arbrisseau
furfuracé : farineux, couvert d’une poussière blanche ou blanc roussâtre
fusiforme : en fuseau
G
galerie (forêt galerie) : formations boisées dont la canopée est jointive au-dessus d’une rivière ou d’un petit fleuve, ou d’une zone humide (la présence de l’eau pouvant éventuellement être temporaire)
galle : excroissance produite sur les plantes sous l’action de parasites (= cécidie)
géminé : disposé par paires
géniculé, genouillé : fléchi ou courbé comme un genou
gibbeux : présentant une bosse bien marquée
glabre : dépourvu de toute pilosité
glabrescent : qui devient glabre, ou presque glabre, à poils très épars
glandulifère : qui porte des glandes
glaucescent : presque glauque
glauque : couleur vert bleuâtre ou bleu-vert blanchâtre
glutineux : collant, à consistance de glu
grappe : inflorescence formée d’un rachis portant des fleurs pédicellées (= racème) ; si l’axe principal n’est pas ramifié la grappe est dite simple ; si l’axe principal est ramifié la grappe est dite composée (= panicule)
gymnosperme : plante à ovule nu, comme le pin
gynécée : organe femelle de la fleur composé d’un ou plusieurs carpelles soudés ou libres
gynodioïque : qualifie une espèce dont certains sujets ne portent que des fleurs femelles, d’autres que des fleurs hermaphrodites, aucun sujet ne portant de fleurs mâles
H
halophile : qui préfère les lieux salés
halophyte : plante croissant sur des sols salés ou dans des eaux salées
haploïde : dont le noyau possède n chromosomes
haplostémone : se dit d’un androcée ayant un seul verticille d’étamines, en général en nombre égal à celui des pétales
hasté : en forme de fer de hallebarde, à base portant 2 lobes étalés latéralement
héliophile : qui aime les situations ensoleillées
hermaphrodite : se dit d’une fleur ayant à la fois un ovaire fertile et des étamines fertiles
hétérogame : se dit d’inflorescence où les fleurs sont de type sexuel différent
hétéromorphe : se dit de plantes dont les feuilles ou d’autres organes ont des formes ou des tailles différentes
hétérophylle : se dit de plantes dont les feuilles sont de formes différentes
hirsute : muni de poils droits, mous et longs
hirtelleux : diminutif de hirsute
hispide : muni de poils raides, dressés, + ou - piquants
hispiduleux : diminutif de hispide
holotype : spécimen à partir duquel une nouvelle espèce animale ou végétale a bénéficié d’une description pour la première fois. Ainsi, l’holotype fait office de référence pour la nouvelle espèce décrite.
homogame : se dit d’une inflorescence où toutes les fleurs sont du même type sexuel
homomorphe : se dit d’un individu dont les feuilles ou d’autres organes sont de forme et de taille semblables
hyalin : de translucide à transparent
hybridogène : se dit d’une espèce fertile issue du croisement d’espèces différentes et dont on ne peut préciser la part génétique exacte qui revient à chacune des espèces originelles
hydrophile : qui est fécondé par du pollen transporté par l’eau (= hydrogame)
hygrophile : se dit d’une plante croissant principalement dans des stations humides
hypogé : se dit d’une germination où les cotylédons restent dans le sol ; qui pousse au dessous du niveau du sol ;
I
illégitime : se dit d’un nom validement publié mais contraire à un ou plusieurs articles du Code de Nomenclature Botanique ; un tel nom ne peut être utilisé comme nom en usage
imbriqué : se dit de pièces que se recouvrent le unes les autres comme les tuiles d’un toit
imparipenné : se dit d’une feuille pennée à nombre impair de folioles
incisé : à limbe moins profondément découpé qu’un limbe lacinié
inclus : ne dépassant pas le bord de la formation enveloppante ; s’oppose à saillant ou exsert
indéfini : désigne un axe dont la croissance est théoriquement illimitée et qui n’est pas dominé normalement par ses rameaux latéraux
indumentum : pilosité, revêtement d’écailles
inerme : sans aiguillon ni épine
infléchi : courbé vers le bas et l’intérieur
inflorescence : groupement de fleurs ; elle est dite définie (centrifuge) ou indéfinie (centripète) ;
infrutescence : inflorescence arrivée à l’état de fruit
infundibuliforme : en forme d’entonnoir
intriqué : à rameaux nombreux, serrés, sans ordre
introgression : incorporation de gènes d’une espèce dans le génotype d’une autre espèce par hybridation suivie de rétrocroisements répétés
introrse : tourné vers l’intérieur
involucre : ensemble des bractées insérées à la base d’une inflorescence
involuté : à bords enroulés vers le haut
isotype : double d’un holotype ou d’un lectotype
L
lacinié : divisé en segments étroits ressemblant à des langues
lagéniforme : en forme de bouteille
laineux : rappelant la laine : à poils longs, doux, couchés, un peu crépus et feutrés
lancéolé : étroitement ovale et allongé comme un fer de lance ; terme à éviter car peu précis et galvaudé ;
laxiflore : se dit d’une inflorescence à fleurs espacées + ou - distantes les unes des autres
lectotype : spécimen du matériel originel sur lequel un nom est fondé, choisi postérieurement (et généralement par un autre auteur) pour servir de type nomenclatural quand l’holotype n’existe pas ou a été perdu ou détruit
lenticelle : petite saillie située à la surface de l’écorce de certaines plantes ligneuses, permettant les échanges respiratoires ;
lenticulaire : en forme de lentille convexe à 2 faces
lépidoté : se dit d’une plante garnie d’une pilosité formée de poils aplatis en forme d’écailles
liber : tissu formé des vaisseaux conducteurs de la sève élaborée (Synonyme : phloème)
limbe : partie élargie et aplatie d’un organe, comme une feuille, un pétale
linéaire : long, étroit, à bords parallèles entre eux
linguiforme : en forme de langue
lobulé : se dit d’un lobe divisé lui-même en lobes secondaires ; ou à petits lobes ;
loré, loriforme : allongé, assez large et à bords parallèles
lyré, lyriforme : se dit d’un limbe obovale, pennatifide, à lobe supérieur élargi, arrondi et plus grand que les autres
M
marcescent : se dit d’un organe se desséchant et persistant plus ou moins longtemps sur la plante avant de tomber
marginal : relatif aux bords
membraneux : mince, souple et +/- translucide
mérithalle : entre-noeud
mésique : d’humidité moyenne, ou à pluviométrie moyenne (forêt mésique)
mésocarpe : couche médiane d’un péricarpe
mésophile : se dit d’une plante croissant principalement dans des stations d’humidité ou de pluviométrie moyenne (plante mesophyte)
moniliforme : se dit d’un organe allongé où des resserrements + ou - réguliers délimitent des segments subsphériques comme les grains d’un chapelet
monochasium : cyme unipare
monoïque : se dit d’une plante portant des fleurs mâles et femelles sur le même sujet
monopodial : à croissance indéfinie à partir du bourgeon terminal
monotypique : se dit d’une famille comprenant un seul genre, ou d’un genre réduit à une seule espèce
mucron : pointe courte, droite et raide à l’extrémité d’un organe
mucroné : pourvu d’un mucron
mucronulé : pourvu d’un mucron très petit
muriqué : se dit d’une surface hérissée de pointes courtes et raides, assez épaisses
mutique : dépourvu d’arête ou de mucron ; qui ne se termine pas par une pointe particulière
N
naturalisé :
se dit d’une plante introduite, qui se dissémine dans un écosystème sans intervention volontaire de l’homme
naviculaire : en forme de coque de bateau
nectaire : glande sécrétrice superficielle émettant un liquide sucré
nectarifère : qui porte un ou plusieurs nectaires
néotype : spécimen choisi comme type nomenclatural et destiné à remplacer les matériaux originaux considérés comme faisant défaut : holotype, lectotype ou paratype
nervation : ensemble et mode de disposition des nervures
nerville : petite nervure reliant les nervures latérales entre elles
nervure : ligne d’un organe, saillant ou non, correspondant à l’un des faisceaux conducteurs parcourant l’organe
neutre : se dit d’une fleur réduite à une ou plusieurs pièces florales stériles, ou ayant des organes sexuels avortés ou non fonctionnels
nexine : dans un grain de pollen, la couche interne de l’exine
nœud : niveau des tiges où naissent les feuilles, les bourgeons donnant les ramifications, quelquefois des racines
noix : fruit sec et indéhiscent, à graine entourée d’un péricarpe induré et osseux
noyau : l’endocarpe devenu osseux ou ligneux dans certains fruits
O
ob- : préfixe qui marque l’inverse ou une forme renversée
oblong : plus long que large, les bords longs étant + ou - parallèles, et arrondi aux 2 extrémités
obsolète : rudimentaire, à peine apparent
obtus : arrondi, non aigu ; se dit d’une extrémité de feuille étroite mais non pointue ;
-oïde : suffixe qui indique une ressemblance de forme ou de texture
ombelle : inflorescence à fleurs pédicellées, toutes insérées au même niveau du sommet d’un axe et disposées sur un même plan
ombrophile : qui préfère les stations de pluviosité les plus fortes
ondulé : se dit d’une surface plane quand elle est marquée de vagues ou de sinuosités perpendiculaires à son plan
orbiculaire : presque circulaire, ou parfois presque sphèrique
orthotrope : qui se tient dressé (contraire de plagiotrope)
ostiole : orifice microscopique situé en grand nombre sur les plantes ; avec les 2 cellules la délimitant, constitue le stomate, siège des échanges gazeux entre la plante et le milieu extérieur
ovale : ayant la forme d’un oeuf
ovoïde : de volume semblable à un oeuf
ovule : corpuscule contenu dans l’ovaire d’un carpelle d’un angiosperme ou attaché à une écaille dans un cône de Gymnosperme. L’ovule fécondé par un grain de pollen représente la graine
P
palmé : se dit d’une feuille simple ou composée dont les lobes ou les folioles rayonnent à partir du sommet du pétiole
panduriforme : de forme obovale, étranglée dans la partie médiane ou inférieure, rappelant la forme du violon
panicule : inflorescence constituée par des grappes disposées elles-mêmes en grappes = grappe composée
papilleux : se dit de petits poils courts et turgescents, + ou - denses, recouvrant une surface mais ne la rendant par rude au toucher
papyracé : qui a la consistance du papier
paratype : spécimen cité dans le protologue par un auteur, qui n’est ni un holotype, ni un isotype, ni un syntype
paripenné : se dit d’une feuille composée-pennée ayant un nombre pair de folioles
parthénocarpique : se dit du développement d’un fruit sans fécondation antérieure, par simple division du gamète femelle ; le résultat est le plus souvent un individu haploïde ;
patelliforme : en forme de plateau, d’assiette
pectiné : se dit d’un organe découpé en lobes étroits parallèles et nombreux, rappelant les dents d’un peigne
pédalé : se dit d’une feuille palmée dont les 2 divisions les plus latérales sont elles-mêmes lobées, les lobes étant orientés vers le bas
pédicelle : ramuscule portant une fleur à son sommet ; segment étroit servant de base à un organe (poil pédicellé)
pédoncule : portion de rameau portant une inflorescence ou une infrutescence
pelté : dont le pétiole est fixé sur le limbe-même, non à sa base ou sur la marge
pénicillé : muni de poils disposées en touffe terminale comme ceux d’un pinceau
pennati- : préfixe qualifiant un organe dont les éléments sont disposés de part et d’autre d’un axe ; pennatifide (les sinus des lobes n’atteignent pas le milieu de chaque demi-limbe), pennatipartite (les sinus dépassent le milieu de chaque demi-limbe) pennatiséqué (les sinus atteignent la nervure médiane)
penné (pinné) : se dit d’une feuille composée à folioles opposées de part et d’autre d’un axe médian ; se dit aussi d’une feuille dont les nervures secondaires sont disposées en 2 rangées de part et d’autre de la nervure principale
pérenne (synonyme : vivace) : caractère d’une plante pouvant vivre plusieurs années, perdant généralement son appareil aérien à la fin de chaque période de végétation mais subsistant pendant la saison froide ou sèche sous forme d’organes spécialisés souterrains chargés en réserve (racines, bulbes, rhizomes) protégeant la plante du froid ou du stress hydrique.
périanthe : ensemble des enveloppes florales différenciées en calice et corolle
péricarpe : paroi du fruit
phénotype : ensemble des caractères apparents d’un individu ou d’une population, extérieurement homogènes mais génétiquement peut-être hétérogènes
phloème : tissu formé des vaisseaux conducteurs de la sève élaborée
phyllomorphe : qui a l’aspect d’une feuille
phyllotaxie : disposition des points d’insertion des feuilles sur une tige ou un rameau
pileux : couvert de poils
pilosité : ensemble de poils, sans indication de nature ou de densité
piriforme (pyri-) : en forme de poire
pistillode : pistil rudimentaire non fertile dans une fleur unisexuée à fonction mâle
pivotant : se dit d’une racine bien développée à ses petites racines latérales et s’enfonçant +/- verticalement dans le sol
plagiotrope : qui pousse horizontalement ou obliquement (contraire de orthotrope)
platanoïde : se dit d’une écorce que s’exfolie en grandes plaques minces
plicatile : se dit d’organes pliés longitudinalement sur eux-mêmes
ploïdie : le degré de ploïdie indique le nombre par lequel est multipliée la série de base de hromosomes présents dans un individu : nomalement il existe 2 séries et l’individu est dit diploïde
plumeux : à poils hérissés de poils plus fins comme les barbes d’une plume
pneumatophore : racine respiratoire aérienne
polygame : plante portant sur le même pied des fleurs unisexuées mâles et femelles et des fleurs hermaphrodites
polymorphe : de formes très variables
préfloraison : disposition des pièces du périanthe avant l’épanouissement de la fleur (= estivation)
préfoliation : disposition des feuilles dans le bourgeon (Synonyme : vernation)
prémorse : se dit du sommet d’un limbe tronqué mais irrégulier, comme s’il était rongé
procombant : couché sur le sol, sans s’enraciner
prostré : couché, appliqué sur le sol
protandre : se dit des fleurs où les étamines arrivent à maturité avant que les stigmates ne soient réceptifs
protogyne : se dit des fleurs où les stigmates sont réceptifs avant que les étamines ne soient mûres
protologue : tout élément associé à la publication originale d’un nom : diagnose, description, illustration, synonymie, références bibliographiques, etc.
proximal : proche de la base d’un organe (contraire de distal)
pruineux : couvert d’une poudre fine, cireuse, +/- glauque, qui s’enlève au toucher
pubérulent : faiblement pubescent
pubescent : à poils courts, fins et mous, + ou - frisés ou sinueux et de densité moyenne
pulvérulentcouvert d’une poudre fine non cireuse
pulviné : élargi en coussinet, ou muni d’une saillie arrondie (pulvinus)
puncticulé : finement ponctué
punctiforme : rappelant un point
pustuleux : qui porte des pustules, des petites vésicules ou saillies
pyrène : un des noyaux d’un fruit drupacé
R
racème : voir grappe
rachis : axe d’une inflorescence, ou axe principal d’une feuille composée-pennée
radial : disposé comme des rayons ; symétrie radiale (= actinomorphe)
radical : se dit de feuilles naissant à partir de tiges souterraines
radicant : se dit d’une tige couchée sur le sol qui s’enracine aux nœuds
radicelle : toute petite racine
radiculaire : relatif à la radicule
radicule : ébauche de racine dans l’embryon ;
ramentacé : couvert de petites écailles membraneuses, sèches, éparses
ramification : division d’un axe principal en axes secondaires
rampant : appliqué au sol et fixé par des racines adventives
récliné : courbé vers le bas
récurvé : courbé vers l’extérieur et le bas
réfléchi : courbé et dirigé vers le bas en faisant un angle aigu avec l’axe principal
réfracté : se dit d’un organe brusquement dirigé vers le bas dès son point d’insertion
réniforme : en forme de rein
réticulé : marqué d’un réseau de lignes, de côtes, de stries ou de nervures
rétrorse : dirigé vers la base d’un organe
rétus : tronqué et légèrement déprimé dans la partie centrale
révoluté : à bords enroulés vers le bas ou vers la face abaxiale ; s’oppose à convoluté
rhombique, - boïdal : en forme de losange
ripicole : qui habite dans les stations des rives des cours d’eau
ripisylve (forêt) (synonyme : rivulaire, riveraine : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours d’eau, d’une rivière ou d’un fleuve, la notion de rive désignant le bord du lit mineur (ou encore lit ordinaire, hors crues) du cours d’eau non submergée à l’étiage. La notion de ripisylve désigne généralement des formations boisées linéaires étalées le long de petits cours d’eau[Information douteuse], sur une largeur de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, ou moins (si la végétation s’étend sur une largeur de terrain inondable plus importante, dans le lit majeur d’un cours d’eau, rivière ou fleuve, on parlera plutôt de forêt alluviale, de forêt inondable ou inondée ou de forêt rivulaire
riveraine : (voir ripisylve)
rivulaire : (voir ripisylve)
ronciné : se dit d’un limbe pennatifide à lobes aigus et rabattus vers la base
rostré : prolongé en forme de bec
rudéral : poussant spontanément dans des sites où s’exerce une activité humaine : sentiers, chemins, cultures
ruguleux : finement rugueux
S
sagitté : en forme de fer de flèche
samare : fruit sec, indéhiscent, monosperme, habituellement comprimé, muni d’une aile
saprophyte : plante dépourvue de chlorophylle et se nourrissant de substances contenues dans les détritus végétaux (humus)
sarmenteux : dont les tiges et les rameaux sont allongés et flexibles comme ceux de la vigne
scabre : qualifie une surface ou un bord portant des poils raides, rugueux au toucher
scalariforme : se dit d’éléments disposés comme les barreaux d’une échelle
scarieux : mince, rigide, sec, translucide à transparent, rappelant la consistance d’une écaille de poisson
sciaphile : qui préfère les lieux ombragés
sclérophylle : plante ligneuse adaptée à des conditions de sécheresse
scorpioïde : enroulé ou courbé en forme de queue de scorpion
scrobiculé : creusé de petites fossettes irrégulières
scutiforme : en forme de bouclier
séminifère : qui porte ou produit des graines
-séqué : suffixe désignant la découpure presque totale d’un organe en segments
séricé : voir soyeux
sérié : disposé en, ou constitué de rangées
serré, serrulé : dont le bord présente des dents aiguës tournées vers le sommet de la feuille, en dents de scie (si dents fines = serrulé)
sessile : sans support, sans pétiole ni pédoncule ni pédicelle
sétacé : se dit d’une soie, d’un poil fin, long et raide
séteux : muni de longues soies
sétuleux : diminutif de séteux
sigmoïde : courbé 2 fois, en forme de S
sillonné : creusé longitudinalement de petits sillons plus profonds que des stries
sinueux, sinué : se dit d’un bord de feuille ayant un tracé légèrement et irrégulièrement "échancré" sans être vraiment lobé
sinus : l’échancrure ou l’angle rentrant situé entre deux lobes ou deux parties saillantes
soie : poil long et raide parfois brillant, + ou - couché
sous-arbrisseau plante ligneuse dont les tiges multiples dès le niveau du sol, sont relativement grêles et ne dépassent guère par la taille celle de nombre de plantes herbacées, soit une taille de moins de 0,5 m de hauteur. Le plus souvent, un sous-arbrisseau typique ne s’élève pas beaucoup au-delà de quelques décimètres. Le sous-arbrisseau est un chaméphyte frutescent tandis que l’arbrisseau est un nanophanérophyte.
soyeux : portant un revêtement doux de poils brillants, longs et couchés
spatulé : en forme de spatule, élargi au sommet
spermatophyte : plante se reproduisant par graines
spiciforme : en forme d’épi
spinescent : s’amincissant en pointe faible rappelant une épine ; faiblement épineux
spinuleux : garni de petites pointes ou épines plus ou moins denses
squameux, -miforme : écailleux, en forme d’écaille
squarreux : se dit de l’aspect hérissé d’une plante ou d’une inflorescence dont les ramifications s’étalent à angles droits ; hérissé, rude et sec au toucher
staminal : relatif aux étamines
staminode : étamine imparfaite sans pollen fertile et parfois sans anthère, dans une fleur unisexuée à fonction femelle
stellé, stellaire : en forme d’étoile
stigmate : partie terminale d’un gynécée, souvent visqueuse, dont le rôle est de retenir les grains de pollen
stipule : pièce située au niveau de l’insertion d’une feuille sur un rameau
stolon : tige rampante, aérienne, ou souterraine, émettant des pousses qui deviennent des individus distincts, ou des tiges florifères
straminé : de couleur paille
strigilleux : à poils simples, aigus, droits, raides, de moins de 0,5 mm
striguleux : comme strigilleux mais à poils de plus de 0,5 mm ; à toucher rude comme celui d’une rape
striolé : finement strié
style : partie étroite et plus ou moins allongée du gynécée, située entre l’ovaire et le stigmate
stylopode : base élargie de certains styles
subéreux : ayant la consistance du liège
subulé : très étroitement triangulaire, rappelant une subule (toute arête droite, raide, en alène, à base assez large)
suffrutex : plante ligneuse qui perd ses ramifications ultimes chaque année
sulqué : profondément sillonné
sympodial, sympodique : à croissance définie, la croissance ultérieure s’effectuant à partir de bourgeons latéraux
syntype : spécimen cité dans le protologue par un auteur qui n’a pas désigné d’holotype ou qui a désigné simultanément plusieurs spécimens comme types
T
taxon : toute entité taxonomique, quel que soit son rang ; parfois désignant abusivement l’espèce
taxonomie : discipline de la biologie consacrée au classement des organismes vivants (= taxinomie)
tessellée : se dit d’un limbe ou d’une surface muni d’un réseau de nervures ayant l’aspect d’un damier
test, testa : tégument externe de la graine
thyrse : inflorescence composée, formée de grappes de cymes
tomentelleux : diminutif de tomenteux
tomenteux : couvert d’un tomentum, càd de poils nombreux, mous et enchevêtrés, cachant entièrement la surface, comme un feutre
trichome : émergence épidermique, simple, souvent ramifiée, parfois indurée ; en pratique = poil foliaire
tronqué : dont l’extrémité est coupée transversalement d’une manière abrupte
tuberculé : à surface garnie de petits tubercules
turbiné : en forme de toupie
U
unciné : recourbé en crochet ou en bec crochu
unisérié : disposé en un seul rang
urcéolé : en forme d’outre ou de grelot (renflé dans sa partie moyenne et un peu resserré à son orifice)
V
valvaire : dont les pièces se touchent seulement par leurs bords, comme un coquillage bivalve
velouté : à pilosité semblable à du velours (synonyme : vélutineux)
vélutineux : à pilosité semblable à du velours (synonyme : velouté)
ventral, e : se dit de la face d’un organe située contre l’axe porteur
vernation : disposition des feuilles dans le bourgeon (synonymie : préfoliation)
verruculeux : couvert de petites verrues
verruqueux : garni de verrues
verticille : ensemble d’organes disposés en cercle à un même niveau
vésiculeux : renflé en forme de petite vessie
vicariant : taxon voisin d’un autre par son écologie et souvent par sa morphologie, le remplaçant à la limite de son aire, ou sur une aire séparée
villeux : densément couvert de poils longs, fins et mous, courbés ou + ou - dressés
vivace (synonyme : perenne) : caractère d’une plante pouvant vivre plusieurs années, perdant généralement son appareil aérien à la fin de chaque période de végétation mais subsistant pendant la saison froide ou sèche sous forme d’organes spécialisés souterrains chargés en réserve (racines, bulbes, rhizomes) protégeant la plante du froid ou du stress hydrique.
XY
xérophile : qui aime les endroits secs ou arides
xylème : ensemble des tissus ligneux formés des vaisseaux conducteurs de la sève brute
Z
zoogame, zoophile : fécondé par du pollen transporté par les animaux
zygomorphe : se dit d’une fleur à symétrie bilatérale
19/05/2020
http://lavierebelle.org/glossaire-botanique-et-ecologique